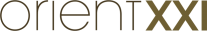Féminisme
+27
ulrik
Vic
iztok
mykha
lomours
Byrrh
Lascar Kapak
Maxence
Jenny K
Achille
Eleanor
Babel
Vals
BouffonVert72
le glode
ramiro
Coyote
Toussaint
Vérosa_2
Roseau
vilenne
verié2
gérard menvussa
jacquouille
irneh09218
sylvestre
fée clochette
31 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
http://www.liberation.fr/societe/2014/03/07/je-veux-marcher-a-cote-des-meres-des-salopes-des-grosses_985440
«Je veux marcher à côté des mères, des salopes, des grosses»
Cécile DAUMAS 7 mars 2014 à 21:16
INTERVIEW
Virginie Despentes regrette la violence des oppositions entre féministes :
Ecrivaine, Virginie Despentes s’est fait remarquer en 2006 par un essai féministe percutant, King Kong Théorie. Elle défend les prostituées, les femmes voilées, les lesbiennes, les vieilles…
Sur le même sujet
Pourquoi être contre la pénalisation du client, et contre la loi sur le voile à l’école ?
La pénalisation des clients est un outil du pouvoir pour contrôler les sans-papiers. Il ne s’agit pas de protéger les travailleuses contraintes, mais de les opprimer davantage. Le féminisme ne devrait pas être instrumentalisé pour permettre au gouvernement de durcir sa politique d’immigration. Le putsch bancaire de 2008 a précarisé les femmes, qui sont les moins bien reçues sur le marché de l’emploi. Il y avait d’autres mesures à prendre pour envoyer un signe de solidarité que de cogner sur celles qui survivent en se prostituant.
Revenir sur la loi du voile à l’école aurait été une vraie mesure de gauche… Car, là encore, il s’agit d’instrumentaliser le féminisme pour mener une politique excluante, qui permet aujourd’hui à l’extrême droite d’encourager les gens à dire «nous retirons nos enfants de l’école, car nous n’avons plus confiance en cette école laïque qui nous a fermé ses portes». C’est très français de dire aux populations issues des anciennes colonies : vous êtes rudement chanceux d’être là, alors fermez vos gueules. Le calme et le silence n’est plus ce qui caractérise les populations issues des anciennes colonies, et on devrait s’en réjouir à gauche. Au lieu de quoi, on invente une école qui déclare que certaines Françaises sont indignes d’être instruites.
L’unité dans le féminisme, c’est possible ?
Quand le cortège du 8 mars, il y a une dizaine d’années, a refusé pour la première fois que les femmes voilées se joignent à la manifestation, je faisais partie de celles que ça a choqué. Ne sont-elles pas assez blanches pour se considérer comme des femmes ? Je ne suis pas une fanatique de la manifestation du 8 mars, mais si j’y vais, je ne vais pas vérifier auprès des meufs, une par une, si elles sont bien athées… j’ai envie de marcher à côté des mères au foyer, des femmes mariées, des travailleuses précaires, des transsexuelles, des salopes, des cadres supérieures, des lesbiennes, des grosses, des vieilles… Car au finale, nous partageons une identité : nous sommes les victimes «naturelles». Quand un homme est torturé et tué en raison de la couleur de sa peau ou de sa religion on dit «attention, malheur, atteinte aux droits de l’homme, crime politique !» Quand tous les jours des femmes sont torturées ou tuées parce qu’elles sont des femmes on dit «ah la la, les hommes, qu’est-ce qu’ils sont méchants». Mais ce n’est pas politique ? Ah non, ça, c’est hormonal. Et très vite, le problème devient «mais elle faisait un jogging toute seule» ou «elle attendait le bus toute seule». Bref, elle était dehors, elle était une femme et chacune d’entre nous doit se souvenir qu’elle n’est pas en sécurité, dehors.
Pourquoi de telles dissensions ?
Les questions qui divisent les féminismes nous séparent d’une façon particulièrement hostile. Cette violence est assez étonnante, car enfin, il n’y a pas beaucoup d’argent à se disputer, ni de postes de pouvoir, alors pourquoi sommes-nous incapables d’avoir des échanges qui nous enrichiraient ? Perso, le féminisme des «bonnes mamans» ne me concerne pas, mais ça m’intéresse de les écouter. Le féminisme musulman, je ne vais pas sauter de joie à chacune de leurs déclarations, mais ça m’intéresse. Ecouter les unes et les autres ne m’empêche pas de savoir où je me situe - par exemple, du côté de celles qui n’ont pas fait d’enfants. On est encore embourbées dans un délire de destin biologique. On a donné l’argent des écoles aux banques, on n’a pas ouvert de structures d’accueil pour les handicapés, il n’y a pas de travail, on va tailler dans les aides aux plus démunis - mais faites des enfants, sinon vous passerez à côté de votre destin biologique. Autant dire : enfoncez-vous le plus possible dans la merde. Je crois qu’il faut valoriser la position des femmes qui ne s’intéressent pas à la maternité. Ceaucescu appelait «les déserteuses» les Roumaines qui ne donnaient pas les cinq enfants exigés pour la patrie. Valoriser cette position, ce n’est pas mépriser les autres. On peut être mère de famille nombreuse et être en accord avec ce qu’on vit, et on peut aussi être une quadragénaire nullipare qui se félicite tous les jours de son choix. Ce qui n’empêche pas d’être solidaire des luttes pour la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes. Etre féministe, justement, ça pourrait être de dire : est-ce qu’on pourrait arrêter de définir à notre place ce qu’est la féminité ?
Le féminisme ringard ou encore libérateur ?
Internet a changé la donne. Si une fille a été violée et qu’elle cherche des informations sur ce qui lui est arrivé, elle trouve des dizaines de textes sur le sujet. Il y a vingt ans, tu étais complètement isolée. Si tu te prostitues, tu trouves sur Internet tout le matériel pour être féministe et prostituée - ça aussi, c’était impensable. Le sexisme dans les jeux vidéo, la violence domestique, la PMA, le porno… quel que soit le sujet, tu trouves. Dans les médias mainstream, paradoxalement, l’affaire DSK a été une excellente nouvelle pour le féminisme : on n’a jamais autant parlé de sexisme, et encore moins du viol, à la télé… et pour la première fois depuis des années en France, on a dû convenir que le sexisme, ce n’était pas réservé aux banlieues… Alors on a entendu des femmes politiques, des journalistes connues s’exprimer : évidemment, oui je suis confrontée au sexisme. On a découvert, quand même sidérées, que l’Assemblée nationale était un lieu d’humiliation quotidienne pour les femmes… Une prise de conscience très importante de l’état des lieux.
Dernier ouvrage paru : «Apocalypse bébé» (Grasset 2010).
Recueilli par Cécile Daumas

sylvestre- Messages : 4489
Date d'inscription : 22/06/2010
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
Tithi Bhattacharya : Comprendre la violence sexiste à l’ère du néolibéralisme

sylvestre- Messages : 4489
Date d'inscription : 22/06/2010
 Cinzia Arruzza: capitalisme et oppression de genre
Cinzia Arruzza: capitalisme et oppression de genre
Un des points de vue les plus répandu chez les théoriciens marxistes est de considérer l’oppression de genre comme quelque chose qui n’est pas nécessaire à l’oppression du capital. Cela ne signifie pas que le capitalisme ne s’en serve pas et ne profite pas de l’inégalité de genre produite par les configurations sociales précédentes. Mais il s’agirait par contre d’un rapport opportuniste et contingent. Dans les faits, le capitalisme n’a pas vraiment le besoin de se servir de manière spécifique de l’oppression de genre, et les femmes ont bel et bien atteint, sous le capitalisme, un niveau de liberté et d’émancipation sans précédents dans les époques historique. Bref, la libération des femmes et le féminisme n’auraient pas un rapport antagoniste.
http://www.avanti4.be/debats-theorie-histoire/article/reflexion-de-genre-3-le-capitalisme-est-il
http://www.avanti4.be/debats-theorie-histoire/article/reflexion-de-genre-3-le-capitalisme-est-il
Antonio Valledor- Messages : 160
Date d'inscription : 01/06/2012
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
Ecoutez le premier interview, de 1959, puis le second, de 1975.
On y trace, en 15 ans, l'évolution de Simone de Beauvoir et du féminisme,
notamment grâce au fait que les femmes, dans la foulée de la vague émancipatrice de 68,
se sont organisées dans un grand mouvement indépendant.
On y trace, en 15 ans, l'évolution de Simone de Beauvoir et du féminisme,
notamment grâce au fait que les femmes, dans la foulée de la vague émancipatrice de 68,
se sont organisées dans un grand mouvement indépendant.

Roseau- Messages : 17750
Date d'inscription : 14/07/2010
 Wassyla Tamzali,
Wassyla Tamzali,
http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_1426150/fr/la-voix-feministe-laique-de-wassyla-tamzali
De la morale sexuelle à la virginité en passant par la polygamie ou le voile, le travail féministe de Wassyla Tamzali a questionné les effets de l’inégalité entre hommes et femmes dans les pays musulmans depuis sa jeunesse avec une vision laïque du féminisme. Dans ses textes, la militante rappelle l’universalité des droits des femmes et l’impossibilité de réduire ou accommoder ces droits selon l’origine ou l’appartenance religieuse des femmes. Dans ce sens, la laïcité doit être l’outil maître pour déconstruire les schémas patriarcaux présents dans la religion et les traditions des pays dits musulmans. Son travail remet, d’abord, en question le relativisme culturel auquel les occidentaux s’attachent pour éviter de critiquer un système de valeurs qui ne respecte pas les droits des femmes, comme c’est le cas de l’Islam, par crainte d’être accusés d’islamophobie, pour ensuite attaquer la mouvance « féministe islamique » née au cœur de ce relativisme culturel dans les pays occidentaux et qui est largement soutenue dans les médias et les recherches sur la question féministe en Islam.
Dans son ouvrage Une femme en colère. Lettre d’Alger aux Européens désabusés, Wassyla Tamzali adresse une critique féroce à la société européenne et à ses intellectuels qui ont renoncé au principe d’universalité des droits des femmes au-delà des frontières européennes, au profit d’un relativisme culturel qui accorderait des droits différents aux femmes, quand elles sont issues des pays musulmans. L’affaire du voile, qui a marqué l’esprit des occidentaux, est analysée dans son texte. Wassyla Tamzali se montre très critique face aux intellectuelles qui prennent la défense du voile, alors même qu’elles se sont battues pour les droits des femmes en France. « Elles n’ont pas renoncé à réaffirmer, chaque fois que c’était nécessaire, que le droit des femmes à disposer de leur corps n’était pas négociable parce qu’il était le pivot de la pensée féministe. Et pourtant, devant les hadiths, versets et autres éléments de la culture charaïque brandis dans les meetings, les défilés, les débats, devant le consentement de certaines femmes à dissimuler leur corps, à le «marquer» des signes de la domination patriarcale par le voile, s’agissant des femmes musulmanes, elles relativisent ce principe pour lequel elles se sont battues, un principe qui perdrait son sens pour des femmes de cultures différentes1 » s’indigne-t-elle dans un passage de son essai. La militante ne prétend pas dans son discours interdire le port du voile, mais, d’un point de vue féministe, elle critique l’usage de ce voile comme instrument d'identification des femmes en quête de la récupération d’une forme de dignité : « Je peux décider librement de porter mon voile, mais le voile ne va pas produire la liberté. On peut s'aliéner librement. Les formes d'aliénation volontaires sont multiples2 » affirmait-elle lors d’une de ses dernières conférences au Québec.
D’un autre côté, Wassyla Tamzali s’est positionnée clairement contre le « féminisme islamique » parce que ces femmes se sont mis une limite, celle du respect de la religion. En partant de cette base, le travail de déconstruction n’aboutit pas à l’émancipation totale de la tradition patriarcale implicite dans les textes religieux. «On pourrait croire que les « féministes islamiques » mènent ce travail de déconstruction puisqu’elles basent leur réflexion sur une relecture des textes et traditions islamiques. Mais elles ne peuvent aller bien loin dans la mesure où dès le départ elles annoncent qu’elles restent dans les limites de leur religion. Veulent-elles réellement aider à la libération des femmes ou apporter la preuve que l’islam a libéré les femmes3 ? » écrivait la juriste dans un de ses articles. En tant que féministe, Wassyla Tamzali et ses compatriotes des pays musulmans avaient déjà fait à l'époque ce travail de déconstruction des textes sacrés, dans un premier temps mais dans le but, disait-elle, « d’aller vers le peuple pour rendre visible l'inégalité et lutter contre celle-ci, pour agir sur le terrain et aller vers plus de liberté ». Leur travail, celui des féministes laïques, a continué dans le sens de la mise au jour de la morale religieuse et la mise en contexte historique de certains commandements religieux, pour démontrer qu’ils étaient caduques dans le contexte actuel. Elle prend comme exemple la question de l’héritage : les textes sacrés disent qu’une sœur ne peut hériter que de la moitié de ce dont hérite son frère, ce qui dans le temps avait du sens parce que les hommes étaient responsables de leurs sœurs, mais de nos jours ce n’est plus le cas. Dès lors, la critique que fait Wassyla Tamzali aux féministes islamiques est la même que celle qu’Arkhoum ou Rhouni leur faisaient déjà en 2005 : « ils reprochent leur «fondamentalisme», c’est-à-dire le fait de n’avoir pas su s'émanciper pleinement de la tradition intellectuelle patriarcale qu’elles entendaient détruire4 »
La critique de Wassyla Tamzali porte aussi sur la place que ces féministes ont en Occident, tant dans les rencontres sur le féminisme, où elles sont présentes en masse, que dans les institutions publiques qui financent leurs recherches : « En favorisant dans ses universités les recherches sur ledit « féminisme islamique » au détriment d’autres recherches, en usant, dans ces politiques sociales et culturelles, les thèses de ce courant, l’Europe trouve là une voie bien hasardeuse pour atteindre ce fameux islam européen que nous espérions paré de toutes les vertus de la modernité, laïcité, féminisme, démocratie » dénonce-elle. La juriste accuse aussi le mouvement féministe islamique dans son aspect politique d’essayer de délégitimer le féminisme qui déconstruit vraiment l’Islam et de favoriser l’islamisation des esprits. « Le féminisme islamique n’existe pas. Ces personnes participent à une propagande visant l’islamisation de la société» répète Wassyla Tamzali dans chacune de ses interventions. Surtout en faisant bien attention à expliquer que dans les pays musulmans ce mouvement n’est pas présent, même si beaucoup des femmes sont amenées à participer à leurs événements. Dans ce sens elle montre en exemple les femmes tunisiennes qui, après la révolution, « n’ont pas voulu militer sur base des textes religieux, elles ont toujours refusé l'interprétation féminine du Coran5.» C’est devenu plus évident encore lorsqu’Ennahda a voulu inscrire dans la constitution le principe de « complémentarité » des femmes par rapport aux hommes, plutôt que celui d’égalité. Les femmes se sont mobilisées en masse pour refuser cette conception islamique de l' « équité », conception qui est d’ailleurs prônée par les féministes islamiques. En définitive, le féminisme est intimement lié à la laïcité pour Wassyla Tamzali, car « on ne peut pas gérer la société avec les textes religieux, la laïcité est très important pour les droits de la femme parce qu’elle nous amène à la déconstruction du système, pour libérer la femme ».

mykha- Messages : 1079
Date d'inscription : 19/06/2013
 Arruzza:Repenser le capital pour repenser le genre
Arruzza:Repenser le capital pour repenser le genre
Dans la précédente « Réflexion de Genre », j’ai voulu éclaircir les limites de la « pensée fragmentée », celle qui photographie les différents types d’oppression et de domination sans en comprendre l’unité intrinsèque, en ramenant chacune de ces facettes à un système autonome. J’avais en outre critiqué la lecture du rapport entre capitalisme et oppression de genre qui repose sur ce que j’ai défini comme l’idée du « capitalisme indifférent ». Il est temps maintenant d’aborder cette fameuse « Théorie Unitaire », ainsi que le concept de « reproduction sociale ».
http://www.avanti4.be/debats-theorie-histoire/article/reflexion-de-genre-4-repenser-le-capital-pour
http://www.avanti4.be/debats-theorie-histoire/article/reflexion-de-genre-4-repenser-le-capital-pour
Antonio Valledor- Messages : 160
Date d'inscription : 01/06/2012
 Entretiens avec Silvia Federici
Entretiens avec Silvia Federici
L’auteure de « Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive », (Entremonde/Senonevero, 2014), la théoricienne féministe Silvia Federici, est née en 1942 à Parme, en Italie, c’est dans ce pays qu’elle fait ses premiers pas dans l’activisme. En 1967, elle s’installe aux Etats-Unis où elle participe activement au mouvement étudiant, aux mobilisations contre la guerre du Vietnam, au mouvement pour les droits civils et, surtout, au mouvement féministe. Dans les années 1980, elle vit au Nigeria où elle donne des cours à l’Université de Port Harcourt et participe à des organisations de femmes en lutte contre les politiques d’ajustement structurel. Elle est aujourd’hui professeure de Philosophie Politique à l’Université Hofstra de Long Island, New York. Sa pensée est fortement influencé par le marxisme « opéraïste » italien, même si elle a toujours été critique vis à vis des principaux auteurs de ce courant, comme par exemple Toni Negri ou Paolo Virno. Elle a développé une œuvre originale autour du mécanisme de l’accumulation par dépossession à partir d’une perspective de genre.
Les deux entretiens que nous publions ci-dessous ont été réalisés lors de sa récente tournée de conférences dans l’Etat espagnol, à l’occasion de la publication en castillan de son ouvrage intitulé « Revolution at Point Zero. Housework, Reproduction, and Feminist Struggle » (Brooklyn/Oakland, Common Notions/PM Press, 2012). Le premier entretien a été réalisé par Hibai Arbide Aza pour la revue « Play Ground » et le second a été mené par Ana Requena Aguilar pour le journal « El Diario ». Elle y aborde une série réflexions stimulantes ainsi que des concepts et des développements qui méritent débat, ce qui constitue précisément tout l’intérêt de ces contributions.
http://www.avanti4.be/analyses/article/dette-appropriation-des-corps-travail
Les deux entretiens que nous publions ci-dessous ont été réalisés lors de sa récente tournée de conférences dans l’Etat espagnol, à l’occasion de la publication en castillan de son ouvrage intitulé « Revolution at Point Zero. Housework, Reproduction, and Feminist Struggle » (Brooklyn/Oakland, Common Notions/PM Press, 2012). Le premier entretien a été réalisé par Hibai Arbide Aza pour la revue « Play Ground » et le second a été mené par Ana Requena Aguilar pour le journal « El Diario ». Elle y aborde une série réflexions stimulantes ainsi que des concepts et des développements qui méritent débat, ce qui constitue précisément tout l’intérêt de ces contributions.
http://www.avanti4.be/analyses/article/dette-appropriation-des-corps-travail
Antonio Valledor- Messages : 160
Date d'inscription : 01/06/2012
 La crise du travail de soins
La crise du travail de soins
Cela fait plusieurs années que l’on parle d’une crise du travail de soins dans l’Etat espagnol et dans d’autres pays occidentaux. Le vieillissement de la population, l’incorporation généralisée des femmes au marché du travail, ainsi que les effets de décennies de politiques néolibérales de privatisations de l’Etat-Providence, tout cela a multiplié les charges et les responsabilités de nombreuses femmes ayant des proches en situation de dépendance. Ces phénomènes ont mis en évidence un vide de « présence » et d’attention pour de nombreuses personnes en situation d’autonomie restreinte...
http://www.avanti4.be/analyses/article/la-crise-du-travail-de-soins-origines-fausses
http://www.avanti4.be/analyses/article/la-crise-du-travail-de-soins-origines-fausses
Antonio Valledor- Messages : 160
Date d'inscription : 01/06/2012
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
http://orientxxi.info/
Ces féministes qui réinterprètent l’islam

Copas- Messages : 7025
Date d'inscription : 26/12/2010
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
Intéressante interview de Caroline de Haas, fondatrice d'Osez le Féminisme, par Rokhaya Diallo, des Indivisibles, sur le thème des "fractures du féminisme".
ALTER EGAUX. Caroline de Haas par Mediapart
ALTER EGAUX. Caroline de Haas par Mediapart

sylvestre- Messages : 4489
Date d'inscription : 22/06/2010
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
https://jenesuispasfeministemais.wordpress.com/

Toussaint- Messages : 2238
Date d'inscription : 09/07/2010
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
http://orientxxi.info/magazine/rhabillons-les-femen,0936
Rhabillons les Femen !
Une réponse féministe marocaine
Orient XXI > Magazine > Point de vue > Soraya El-Kahlaoui > 16 juin 2015
Le 2 juin dernier, deux Femen françaises, seins nus, s’embrassaient sur l’esplanade de la tour Hassan à Rabat, prétendant manifester de la sorte leur solidarité avec la communauté LGBT marocaine. Si certains militant-e-s et féministes ont pu y voir un geste fort anti-homophobie et anti-patriarcat, d’autres dénoncent une attitude paternaliste et post-coloniale qui ne peut que nuire aux luttes d’émancipation menées au Maroc par les femmes et les groupes marginalisés.
Marche des femmes pour l'égalité, Rabat, 8 mars 2015.
D. R.
Deux activistes des Femen ont débarqué mardi 2 juin à Rabat pour une action seins nus sur la très symbolique esplanade de la tour Hassan. Le poing levé, c’est en se donnant en spectacle dans un baiser « intersexe » que ces deux activistes ont entendu manifester leur solidarité avec le groupe LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) au Maroc. Cette petite escapade en « terre d’Arabie » qui marque la première venue des Femen au Maroc a été interprété par certaines féministes progressistes et par certains militants LGBT comme un geste fort censé venir éclairer nos sociétés archaïques et sauver nos mentalités dégénérées par l’homophobie et le patriarcat arabe.
Pourtant, ce qu’expriment les actions éclair des Femen qui « font le buzz » n’est rien d’autre qu’un mépris envers toutes les femmes qui luttent depuis des années au sein de la société marocaine. C’est de ces femmes-là que l’on devrait normalement parler. Celles qui militent au grand jour, mais aussi celles qui décident de lutter dans l’ombre, celles qui refusent même, parfois, de se définir féministes mais qui sont de fait des femmes qui se battent au quotidien dans la société marocaine.
Il serait bon de rappeler aux quelques défenseurs marocains des actions des Femen que ce groupe d’activistes n’est en rien représentatif de la cause féministe. Il en est même la manifestation la plus dévoyée et la plus odieuse. D’ailleurs, de nombreuses féministes, y compris occidentales, dénoncent le caractère islamophobe et impérialiste de leurs actions. Deux critiques majeures sont à retenir. Premièrement, ce groupe d’activistes instrumentalise le corps des femmes en exhibant des plastiques qui répondent complaisamment et en tous points aux standards imposés par les canons de beautés eurocentrés. Deuxièmement, en imposant leurs agendas politiques sans concertation ni même prise en compte des stratégies internes et propres aux dynamiques des différentes luttes existantes au Maroc, elles participent à monopoliser et à façonner un débat déconnecté des réalités locales.
Si les critiques fusent à l’encontre des Femen, c’est bien parce que bon nombre de féministes s’insurgent de la direction qu’elles font prendre à la cause des femmes en général. Ces critiques ne sont pas l’expression d’un archaïsme ; elles témoignent en réalité de l’effervescence des féminismes qui s’inventent et se pratiquent de par le monde. Aujourd’hui, un feminism of color existe, de même qu’un « féminisme islamique », et bon nombre de féministes du Nord dénoncent elles aussi le racisme structurel induit par ce type de discours qui infériorise, au nom de la liberté des femmes, les sociétés post-colonisées. En créant l’image d’une communauté musulmane minée par le « patriarcat arabe », les Femen produisent un discours qui réduit les rapports de force à une sorte de pathologie culturelle.
Plus grave encore, en imposant un discours essentialisant, les Femen tentent également d’imposer des pratiques de résistance. Avec leur guide de bonnes pratiques militantes, elles ne font que reproduire un discours paternaliste tout à fait insupportable à toute personne qui entend s’inscrire dans une lutte pour l’émancipation. Les actions paternalistes, de type Femen, qui bénéficient, usent, et abusent du white privilege (privilège blanc) ne peuvent qu’engendrer des dégâts néfastes à toute possibilité d’instauration d’un dialogue social autour de questions aussi épineuses que celle de la dépénalisation des pratiques sexuelles — en particulier homosexuelles —, au Maroc. En effet, ce type d’action qui instrumentalise la question des libertés individuelles participe à dépolitiser les questions sociales, notamment en refusant de pointer les causes politico-structurelles à l’œuvre dans la criminalisation des mœurs, au profit d’un mépris sociétal et d’un discours pathogène.
Toutefois, en dépit de tous les efforts déployés par des groupes assimilés à l’hégémonie occidentale, une alternative s’organise. Il est important de savoir qu’existe une pluralité de voix issues des sociétés post-colonisées, qui dialoguent et essaient de trouver leur propre voie d’autonomie. Elles donnent du courage, car bon nombre de défenseurs du féminisme « va-t-en-guerre » pensent que tout ce qui ne répond pas aux critères érigés par un féminisme eurocentré est une offense à la cause des femmes et une défense du patriarcat. Et ils sont nombreux et surtout ils (ou elles) sont ceux qui ont le pouvoir, tant médiatique que politique.
À ces critiques, il faut simplement oser dire non !
Il faut oser dire, que nous, femmes marocaines, nous ne voulons plus être le bras droit d’un féminisme qui se veut prétexte à une réduction de l’homme arabe au patriarcat.
Il faut oser affirmer que ce type de féminisme laïcard, éradicateur, exprime non seulement un mépris de classe repris par certaines de nos élites progressistes, mais surtout qu’il infériorise notre culture en niant totalement les expressions complexes et diverses des résistances des femmes qui s’expriment et se pratiquent constamment dans le quotidien marocain.
Il est temps d’oser affirmer que nous avons le pouvoir et le devoir de ne pas vouloir que la cause des femmes soit le prétexte à des discours impérialistes, directement empruntés aux discours coloniaux. Des discours utilisés pour justifier les interventions étrangères et les politiques islamophobes qui affectent négativement toute la diaspora maghrébine en Europe.
Et, pour ce qui est de notre émancipation, que les féministes du Nord cessent de s’inquiéter : on s’en charge !
MO2014- Messages : 1287
Date d'inscription : 02/09/2014
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
Quelques pages du livre de Christine Delphy Les Uns derrière les Autres.
Les Uns derrière les Autres
Ce qui réunit les textes présentés ici, c’est le souci d’exposer le traitement matérialiste de l’oppression, de la marginalisation, mais aussi de la domination et de la normalité. Ces thèmes sont des paires d’opposition dont l’un des termes ne va pas sans l’autre. Refrain déjà connu, dira-t-on. Certes, mais leçon peu retenue. Il s’agit d’insister sur ce que j’ai répété au cours des années, et principalement à propos de l’opposition entre les femmes et les hommes : la division se construit en même temps que la hiérarchie et non pas avant. C’est dans le même temps, par le même mouvement, qu’une distinction ou division sociale est créée, et qu’elle est créée hiérarchique, opposant des supérieurs et des inférieurs.
Cette théorie s’applique, comme je l’ai déjà écrit ailleurs1, aux divisions qui sont faites à l’intérieur d’une société, et sont à la fois dichotomiques et exhaustives ; si on n’est pas dans un groupe, on est dans l’autre.
L’autre justement, et même l’Autre – avec majuscule – est souvent invoqué comme explication des phénomènes dont je traite ici, l’oppression des femmes, celle des non-Blancs, celle des homosexuels. Pour mettre fin aux discriminations fondées sur le genre, la race ou la sexualité, ou sur tout autre chose, il faudrait et il suffirait que nous nous décidions une bonne fois pour toutes à « accepter l’Autre ».
Des articles de presse aux écrits de philosophes, sociologues et autres savants, il ressort souvent que la hiérarchie de notre société serait due au « rejet de l’Autre ». Sauf en ce qui concerne l’opposition « capitaliste » et « prolétaire ». Non que celle-ci n’ait été traitée de cette façon en son temps : mais le marxisme y a, en cent cinquante ans, substitué une analyse matérialiste.
Depuis 1975, date à laquelle j’ai écrit « Pour un féminisme matérialiste2 », j’oppose à toutes les « explications » idéalistes de l’oppression des femmes une démarche matérialiste. Et la thèse selon laquelle les êtres humains ne supportent pas « la différence » est une thèse sur la nature humaine, une thèse essentialiste donc idéaliste. Cette démarche n’est pas réservée à l’oppression des femmes et j’ai réuni ici des textes traitant aussi de l’oppression des non-Blancs et de celle des homosexuel-le-s.
Ce qui est commun à ces trois oppressions, c’est que chacune divise l’ensemble de la société, l’ensemble de la population, en deux catégories, en deux camps. Mais chacune crée sa propre ligne de partage et divise la même population de départ – ici on dira la population vivant sur les territoires français – de façon différente. Les principes de division étant différents, les groupes dominés et dominants constitués par un principe ne sont pas les mêmes que ceux constitués par un autre. Mais parce qu’il s’agit toujours de la même population de départ, et que chaque division est exhaustive, chaque groupe dominant et chaque groupe dominé par un principe est à nouveau disséqué par le deuxième, puis par le troisième principe de division. Ceci aboutit à ce que chaque personne est nécessairement classée en femme ou homme, mais aussi nécessairement en non-Blanche ou Blanche, et nécessairement aussi en homosexuelle ou hétérosexuelle. Ainsi on peut être dans le groupe dominé d’une division, dans le groupe dominant d’une autre et à nouveau dans le groupe dominé d’une troisième, comme on peut être dominé dans les trois divisions ou dominant dans les trois.
L’articulation, l’imbrication ou l’intrication de ces différentes oppressions, la combinatoire qui résulte de leurs croisements, sont l’un des grands sujets de la sociologie, en particulier de la sociologie féministe. Mais ce n’est pas le sujet de ce recueil. En rapprochant des textes consacrés aux oppressions de genre, de race et de sexualité, c’est la similitude des opérations mises en œuvre pour surqualifier un ensemble de personnes et sous-dis-qualifier celles qui ne sont pas les premières que je veux souligner.
Je veux aussi montrer que la problématique de l’Autre comme explication du sexisme, du racisme, de l’homophobie ou de toute autre hiérarchie sociale non seulement ne marche pas, mais suppose déjà l’existence de cette hiérarchie.
L’objet de ce recueil est donc de démontrer d’abord que la haine du « différent » n’est pas un trait « naturel » de l’espèce humaine ; d’abord en examinant la façon arbitraire dont la tradition occidentale, formalisée dans la philosophie, a posé comme élément constituant et universel du psychisme humain cette haine, et inventé le concept d’« Autre » ; puis en montrant que c’est la société – et non une hypothétique « nature humaine », qui est un concept idéologique – qui construit cet « Autre » par des pratiques concrètes matérielles, dont font partie des pratiques idéologiques et discursives.
Ces textes partagent la même problématique, mais sont par ailleurs de styles et de formats très divers, qui reflètent la diversité des circonstances de leur production : « papiers » académiques pour des congrès ou des revues, interventions dans des meetings politiques, articles de journaux, auditions devant des comités gouvernementaux.
Le concept d’Autre comme invention de la tradition occidentale
Il y a deux raisons pour lesquelles la « haine du différent » ne peut être invoquée pour expliquer l’existence de groupes stigmatisés dans nos sociétés.
La première est que l’explication par « le rejet de l’autre » est un psychologisme, c’est-à-dire la transposition de théories formulées sur le psychisme individuel à des phénomènes concernant le fonctionnement des sociétés.
La seconde est que cette psychologie – ces théories sur le psychisme individuel – sont elles-mêmes des parties d’une philosophie particulière, occidentale, qui aborde la question de « l’autre personne » du point de vue du « je ». Je commencerai par la seconde.
I. Rien qu’en décrivant la question telle que la philosophie occidentale l’a historiquement abordée, la prééminence du « je » apparaît d’emblée. Quand je parle de la philosophie, j’entends par là les fondements invisibles, souterrains, de la vision du monde (Weltanschauung) communément partagée dans une culture3. Ce caveat fait, on peut dire que depuis Platon, la vision du monde occidentale – telle qu’elle est exprimée par les gens qui ont le mérite de révéler ces fondements, les « philosophes » – avant d’être une réflexion sur le monde, est une réflexion sur soi. Cependant, elle reconnaît l’existence du monde, et dans la mesure où elle le fait, elle est justifiée à examiner à partir de quel point de vue elle le fait, et ce point de vue est celui du « je ». Mais, dans cette philosophie, le « je » est seul. Seul, et constituant. Il ne se pose pas la question de l’autre personne, car cette autre personne n’est pas nécessaire ; elle est superflue. Le « je » incarne la conscience, et du moment où il existe une conscience humaine pour voir le monde et se voir en train de le voir, nul besoin qu’il existe une autre conscience. Cette conscience première et unique, uniquement nécessaire, dit avec Descartes : « je pense donc je suis », mais ne se demande jamais quelles sont les conditions de possibilité de sa pensée.
Descartes par exemple, nonobstant le désopilant récit qu’il fait de son enfance dans la première Méditation, n’a pas été mis au monde, nourri, le langage lui est venu tout seul, il a su écrire sans que personne ne le lui apprenne – et on ne sait pas pourquoi il écrit, puisqu’il n’écrit apparemment pour personne. Les conditions de possibilité de son existence, qui font qu’au jour J il peut prendre une plume, du papier et écrire « Cogito ergo sum », et que pendant ce temps il n’a ni faim, ni soif, ni froid (on y veille), lui sont parfaitement indifférentes, il n’y voue pas une demi-pensée. Plus d’une femme d’universitaire reconnaîtra son mari dans ce portrait. C’est donc une philosophie de dominants, pour lesquels la vie matérielle se déroule à leur bénéfice – les nécessités de leur survie sont remplies – mais en dehors d’eux. Ce dédain des conditions de possibilité de sa propre existence et de sa propre pensée est même poussé plus loin ; c’est l’ensemble de la société qui est nié. Or aucun individu ne peut exister en dehors de la société. Il ne peut exister d’être humain sans société, il ne peut exister de pensée sans langage ; une collectivité, même réduite à quelques dizaines de personnes, est indispensable pour que des individus existent. La notion même d’individu est linguistique et donc sociale. L’hyperindividualisme de la philosophie occidentale confine au solipsisme et à l’autisme. Il ne peut être la fondation d’une psychologie valable, qui devrait prendre en compte les conditions qui rendent possible non seulement tel ou tel psychisme individuel, mais le psychisme tout court.
Or c’est de la psychologie fautive constituant une des parties majeures de la philosophie occidentale que nous vient la notion d’Autre comme réalité préexistante et en somme « naturelle ». Dans cette tradition occidentale formulée puis renforcée par les philosophes, c’est chez Hegel que l’autre personne apparaît comme une « question philosophique » dont il faut rendre compte, et cet-te autre apparaît comme une menace pour l’expression du sujet, ce que résumera Sartre avec sa fameuse formule : « Chaque conscience veut la mort de l’autre. »
Ainsi la philosophie occidentale, qui prétend dire la vérité sur l’être humain, indépendamment du lieu ou de l’époque, sur un être qui n’est donc spécifié par rien qui doive à sa situation concrète dans une société donnée, décrète que « l’autre personne » est un danger. Cette philosophie pose que l’objet de son étude, l’être-humain-en-général, ne peut que s’alarmer de l’existence de l’autre personne, et s’en passerait volontiers si c’était possible. Penser la condition humaine, pour la tradition occidentale, c’est la penser à partir d’un être humain seul sur terre, et qui préférerait le rester.
Cette philosophie est donc simultanément une psychologie puisqu’elle décrit ou prédit des réactions (d’inquiétude face à l’autre personne) et des désirs (de solitude). Et en tant que psychologie, cette théorie n’est pas seulement solipsiste : elle est carrément folle. Car, comme l’écrit Francis Jacques dans une brillante synthèse, elle en arrive à se dire : « Si l’être existe, pourquoi les êtres ? Si l’un existe, pourquoi le multiple4 ? » Elle est folle en ce qu’elle nie la réalité du monde des êtres humains (et d’ailleurs de tous les êtres animés), y compris du sujet de la conscience sur laquelle elle discourt. L’expression paradigmatique de la vision occidentale est incarnée aujourd’hui par la psychanalyse orthodoxe (Freud et Lacan), qui est devenue non seulement la base de la psychologie enseignée en France dans les universités, mais la « science » la plus vulgarisée dans le grand public. Or elle en arrive à la limite extrême du solipsisme : à poser l’existence d’une « réalité intra-psychique » qui n’aurait rien à voir avec ce qui se passe ou s’est passé dans la vie des individus.
II. Mais venons-en à la première raison qui rend l’explication par le « rejet de l’Autre » inadéquate. En effet, quoi qu’il en soit de la validité des théories psychologiques au niveau où elles prétendent se placer (le fonctionnement psychique individuel), on ne peut en aucun cas en faire la base d’une explication des rapports entre groupes.
Car même si on avait affaire à une psychologie matérialiste où l’autre personne est toujours déjà présente dans la conscience de chacun-e, il y a, dans ce passage de la psychologie à la sociologie, un changement d’échelle qui est épistémologiquement injustifiable.
La sociologie scientifique se heurte sans cesse à ce réductionnisme psychologisant de la sociologie spontanée qui explique tautologiquement les violences policières par la brutalité des policiers et les violences conjugales par le mauvais caractère des maris. En réalité, bien entendu, c’est l’organisation sociale qui non seulement rend des individus violents mais aussi leur permet la violence, et non des traits pré-sociaux des individus.
Mais pourquoi la sociologie spontanée est-elle fondée sur une vision aussi fausse, individualisante et essentialiste ? Sinon parce que cette vision, qui implique que les rapports entre les gens ne sont pas organisés par la société, est justement l’idéologie de notre société ?
L’impossibilité méthodologique de transposer le niveau de la conscience individuelle au niveau social, d’appréhender les groupes et les rapports entre eux comme répliquant, sur une grande échelle, les processus mentaux individuels ou inter-individuels, est un point acquis dans les sciences. La société n’est pas un grand individu ; elle ne peut être expliquée que par des processus sociaux, qui ne sont pas du même ordre que les processus psychologiques.
Ainsi, même si notre psychologie individuelle était du type décrit par la philosophie occidentale, même si cette psychologie dictait à chacun-e de nous d’avoir peur de « l’autre personne », cela ne serait d’aucun secours pour expliquer pourquoi des groupes entiers sont vus comme et nommés « autres » par d’autres groupes entiers.
C’est pourtant ce qui se passe quand nous sommes exhortés sans cesse, en tant qu’individus mais aussi en tant qu’ensemble d’individus, en tant que groupe qui s’appelle « Nous », à « accepter l’Autre » pour en finir avec le sexisme, le racisme, l’homophobie.
La création collective, l’organisation qu’est la société, s’impose aux individus, et préexiste à chacun d’entre eux – car nous naissons dans une société déjà existante. Elle ne peut cependant pas pour autant être conceptualisée comme un individu surdimensionné. Ni comme la somme des individus qui s’y trouvent. Elle est un phénomène totalement distinct des individus. Elle a besoin d’eux, car une société ne peut vivre sans membres, et ils ont, encore plus, besoin d’elle, car en dehors d’une société, un être humain ne peut être humain ni simplement survivre. Mais cette interdépendance ne signifie pas que ces deux phénomènes aient les mêmes règles de fonctionnement. La société n’est pas un individu. Si on peut admettre que chaque individu, enfermé dans sa peau et dans ses sensations physiologiques et psychologiques, perçoive l’autre personne comme distincte de lui – sans forcément en avoir peur et le rejeter ! – il n’en va pas de même de la société. Elle ne peut donc avoir un problème avec « l’autre » personne, car elle n’a pas de psychisme : l’expression « conscience collective » est une métaphore.
« L’autre par excellence, c’est le féminin, un arrière-monde qui prolonge le monde » (Emmanuel Lévinas5)
À méditer par les Autres qui croiraient que les Uns plaisantent quand ils ne les traitent pas comme des êtres humains. Revenons à l’exhortation à l’acceptation de l’Autre, ou de « l’altérité », ou de « la différence ». C’est vague, l’Autre : ça peut être Autrui, mon semblable en Dieu ou en l’humanisme, bien que ça ne se voie pas au premier abord. Ça peut être aussi toute une bande d’autres et en général, c’est ça : c’est un groupe, stigmatisé, dont on ne dit d’ailleurs pas qu’il est stigmatisé.
On le comprend parce qu’on l’appelle « l’Autre » et qu’on sait que nous avons « du mal à accepter l’Autre ». Ce discours est si fréquent qu’il est impossible de passer une journée sans le lire ou l’entendre, et cependant, il recèle lui aussi un mystère. Tout le monde a l’air de savoir qui sont ces Autres ; tout le monde parle d’eux, mais eux ne parlent jamais.
En effet, dans quels discours apparaît l’Autre, sous sa forme singulière ou plurielle ? Sous la forme d’un discours adressé à des gens qui ne sont pas les Autres. Mais d’où viennent alors ces Autres ? Y a-t-il des Autres, et si oui, pourquoi ? Il faut, pour éclaircir ce mystère, en revenir à l’invite. Qui est invité à accepter les Autres ? Pas les Autres, évidemment. Et qui fait cette demande ? De son énonciateur, qui ne dit pas son nom, tout ce qu’on sait, c’est qu’il n’est pas un Autre. Ce n’est pas lui-même qu’il nous invite à accepter. Mais pas plus qu’il ne dit qui il est, il n’énonce qui est ce « Nous » à qui il s’adresse. Derrière l’Autre dont on entend parler sans arrêt, sans qu’il parle, se cache donc une autre personne, qui parle tout le temps sans qu’on n’en entende jamais parler : l’« Un », qui parle à « Nous ». C’est-à-dire à l’ensemble de la société de la part de l’ensemble de la société. De la société normale. De la société légitime. De celle qui est l’égale du locuteur qui nous invite à tolérer les Autres. Les Autres ne sont pas, par définition, des gens ordinaires, puisqu’ils ne sont pas « Nous ». Qui est ce « Un » parlant ? Avant toute autre chose, on sait, parce qu’il le fait, qu’il est celui qui peut définir l’Autre. Ensuite, il prendra une position de tolérance ou d’intolérance. Mais cette prise de position est seconde par rapport à sa capacité à définir l’Autre : à ce pouvoir. Les Autres sont donc ceux qui sont dans la situation d’être définis comme acceptables ou rejetables, et d’abord d’être nommés.
Au principe, à l’origine de l’existence des Uns et des Autres, il y a donc le pouvoir, simple, brut, tout nu, qui n’a pas à se faire ou à advenir, qui est.
Le mystère de l’Autre se trouve résolu. L’Autre c’est celui que l’Un désigne comme tel. L’Un c’est celui qui a le pouvoir de distinguer, de dire qui est qui : qui est « Un », faisant partie du « Nous », et qui est « Autre » et n’en fait pas partie ; celui qui a le pouvoir de cataloguer, de classer, bref de nommer.
Dans la théorie psychologique de la « guerre des consciences », si chaque conscience veut la mort de l’autre, cette haine est parfaitement réciproque. Et l’une des raisons substantielles – la principale étant épistémologique – pour laquelle on ne peut transposer cette théorie psychologique (à supposer qu’elle ait à son niveau une validité quelconque), c’est que dans la société, ce qui caractérise les rapports et même la définition de l’Un et de l’Autre, c’est l’absence totale de réciprocité. Les Autres, justement parce qu’ils sont les Autres, ne peuvent appeler les Uns des Autres. Et pourtant, s’il est question de « différence », ne pourrait-on dire que l’Un est aussi différent de l’Autre que l’Autre l’est de l’Un ? Bien sûr que si. À « tu n’es pas pareil que moi » répond, à la fois logiquement et dans les cours de récréation, « non, c’est toi qui n’est pas pareil que moi ». À la prépondérance d’un Moi pris comme moi de référence, répond la prépondérance d’un autre Moi. Mais c’est précisément ce que l’Autre ne peut pas faire : se placer comme référent du monde, construire ses Autres. Cette absence de réciprocité confirme que le statut d’Autre n’est pas dû à ce qu’est l’Autre (de quelque façon qu’on définisse ce que « être » veut dire), mais à son absence de pouvoir, absence de pouvoir qui contraste avec le pouvoir de l’Un.
Aussi cet Autre n’est-il jamais maltraité en raison de qualités ou de défauts qu’il exhiberait en tant qu’individu ou que groupe ; il est maltraité d’entrée de jeu, au moment même où on commence à le désigner comme « Autre ».
Il faut insister sur ce point, qui est l’un des messages centraux de mon travail, que je n’ai cessé de dire et de redire de différentes façons. On pense souvent l’oppression d’un groupe par un autre en imaginant que ces deux groupes d’abord existent, puis qu’un rapport de forces s’établit entre eux, rapport que l’un gagne, souvent parce que l’Un est « chez lui », tandis que l’Autre « débarque ». Et la théorie de l’Autre est largement utilisée pour ce faire. Mais les femmes n’ont jamais « débarqué » dans aucun groupe humain. Elles ont toujours été là. Autant pour la théorie du débarquement. Cependant, on dit souvent : les hommes ont donné aux femmes un statut d’Autre. Mais pour le faire il fallait que les hommes existent déjà, non ? Pourquoi et comment le groupe des hommes a-t-il été créé, avec son antonyme nécessaire, le groupe des femmes, dans une société où les individus qui allaient être nommées « femmes » existaient déjà concrètement (mais sans nom) ? Pourquoi et comment la société s’est-elle divisée en deux groupes opposés – dont chacun est censé être à la fois le contraire et le complémentaire de l’autre, dans le même temps que l’un est supérieur et l’autre inférieur ?
En admettant même que ces groupes pré-existent à la relégation de l’un dans le statut d’Autre, pour que les femmes se soient laissées faire, pour qu’elles se soient laissées coller un statut d’Autre, il fallait que les hommes soient déjà les plus forts, non ? Donc on est obligé de conclure que si les hommes sont parvenus à dominer les femmes, c’est parce que… ils les dominaient déjà. On se demande à quoi sert alors le détour par « l’altérité » ? La réponse est qu’il ne sert à rien. Ou plutôt : « l’altérité » naît de la division hiérarchique, elle est en à la fois le moyen – évidemment les inférieurs ne font pas les mêmes choses que les supérieurs, sinon à quoi ça servirait que quelqu’un commande – et la justification : « Moi je conduis le tracteur pendant qu’elle hisse les bottes à la fourche sur la remorque, oh !, c’est dur d’être sur le tracteur, le sang se transforme en boudin ! »
Quand par exemple Lévinas présente les femmes ou la femme comme le prototype de l’Autre, c’est qu’il conçoit déjà l’humanité, celle qui dit « Je », celle qui dit « Nous », comme constituée nécessairement mais aussi exclusivement du groupe des hommes. Il y a l’humanité, à ma droite, et à ma gauche, le moyen, l’instrument, l’annexe, l’appendice adventice de l’humanité, qui n’est là que pour « aider » la première. Quand un groupe en appelle un autre « Autre », il est déjà trop tard, il a déjà accaparé l’humanité véritable et accomplie comme sa caractéristique propre et exclusive. Mais ceci suppose-t-il que le groupe « les hommes », par exemple, préexiste à cet accaparement ? Non seulement cela ne le suppose pas, mais cela suppose le contraire : « les hommes » est le nom que se donne la collection d’individus qui ont dépossédé tous les autres êtres humains de leur qualité humaine. Comme le groupe « les Blancs », comme le groupe « les hétérosexuels ».
La hiérarchie ne vient pas après la division6, elle vient avec – ou même un quart de seconde avant – comme intention. Les groupes sont créés dans le même moment et distincts et ordonnés hiérarchiquement.
La discrimination : un mode de vie
La réunion des articles présentés ici n’a pas pour objet d’étudier les causes et les mécanismes d’oppression des trois groupes dont il est question, les femmes, les homosexuel-le-s et les non-Blancs, puisque la seule oppression sur laquelle j’aie travaillé en détail est celle des femmes. Je ne prétends ni faire la théorie de ces trois oppressions, ni, à plus forte raison, les comparer entre elles.
Ce que je souhaite montrer, c’est un aspect seulement de ces oppressions, un aspect idéologique et discursif qui leur est commun et qui est probablement commun à toutes les situations de domination. Cet aspect idéologique et discursif n’est ni le point unique ni le point central de l’oppression. Toutes les oppressions ont des causes et des conséquences matérielles. Les procédés discursifs ne sont d’ailleurs pas distincts des actes, ils les accompagnent toujours et sont des actes eux aussi. Par exemple, le racisme ne se résume pas, comme certains « spécialistes » le prétendent, à des théories, qu’elles soient « raciales » ou « racialistes », « biologisantes » ou « culturalistes », sur lesquelles se fonderaient les « préjugés » des Blancs sur les Noirs, les Arabes et les Juifs. Le racisme inclut aussi, et même surtout, ce qui est subi par les personnes confrontées à la discrimination dans tous les domaines ; cette discrimination, comme l’hostilité et la violence qui l’accompagnent souvent, ont des effets sur leur vie matérielle, sur leur conception de la vie, sur leur confiance à l’égard d’autrui, sur leur optimisme ou leur pessimisme quant à leur avenir, sur leur estime de soi.
Or, ce n’est que récemment qu’on a commencé à prendre en compte les victimes comme des protagonistes à part entière du racisme, à considérer qu’il valait la peine de s’attarder sur les effets du racisme sur eux/elles. De même, le concept de discrimination était ignoré aussi bien des chercheurs que des juges français, car ils ne voulaient prendre en compte que la discrimination directe, à l’égard d’un-e personne, et niaient ce que les Américains et les Anglais avaient réalisé depuis des années : la discrimination se mesure statistiquement. En ce qui concerne la race, on prétendait que ces mesures étaient, sont toujours impossibles, car il est illégal de demander la race de quelqu’un. Mais en ce qui concerne le sexe, qui est au contraire une mention obligatoire, les statistiques, faciles à obtenir, n’existaient pas plus. Il a fallu que l’Europe insiste, en cette matière comme en d’autres, et force littéralement la France à produire des statistiques sexuées qui démontrent clairement la discrimination patriarcale. Si on continue à refuser les « statistiques ethniques », ce n’est pas pour les raisons avancées, mais pour des raisons culturelles et sociales profondes. Car si le concept même de discrimination ne parlait pas plus aux chercheurs qu’aux juges, c’est parce qu’il n’a pas de sens dans notre culture, dans notre société. Nous vivons dans un univers où il est non seulement normal de préférer un individu à un autre, un parent à un étranger, un homme à une femme, un « vrai » Français à un Arabe (dit aussi « Français de papier ») ; mais où cela fait partie des prérogatives de tout patron, et où il a raison de suivre ces préférences qui assurent que chacun-e est à sa place, que l’ordre social est respecté : les Arabes faisant du « travail d’Arabe », les femmes du « travail de femme ». Tout à coup, on leur dit que ce qu’ils font, avec un fort sentiment de leur bon droit et de leur utilité sociale, est non seulement moralement, mais peut-être même juridiquement répréhensible. C’est tout un pan de nos valeurs, tout un pan de notre représentation du monde, tel qu’il est et doit être, qui s’effondre.
Accepter la notion même de discrimination, c’est-à-dire qu’une femme ou un Noir devraient être pris en compte à l’égal d’un homme ou d’un Blanc, que c’est la nouvelle norme, représente pour la population française blanche et la population masculine une mutation culturelle : c’est tout simplement « le monde à l’envers ». Mais cette nouvelle norme n’est pas seulement un bouleversement culturel : elle annonce la perspective pour cette population masculine et blanche de perdre les bénéfices qu’elle retire de la discrimination. En effet, plutôt que de « discrimination contre », ce qui implique que certains perdent tandis que personne ne gagne rien, il est plus exact de parler des avantages que certains gagnent et qui sont le but du jeu, et donc de parler de « préférence » : « préférence masculine », « préférence blanche ». Celle-ci assure aux hommes et aux Blanc-he-s les postes de décision, les postes de maîtrise7, les postes tout court8 quand ils sont rares. De plus, parler de préférence rend mieux compte de la façon dont les acteurs vivent ces processus de choix.
Fabriquer de l’Autre
Revenons aux procédés discursifs et idéologiques ; ceux dont je parle ici ne sont pas les opinions racistes, sexistes ou homophobes. Le groupe-maître, le groupe des Uns, n’est pas le même dans ces trois oppressions : c’est celui des hommes vis-à-vis des femmes, celui des hétérosexuels vis-à-vis des homosexuels, celui des Blancs vis-à-vis des « non-Blancs ». Cependant, dans chaque cas, le groupe maître a la même rhétorique : il reproche à « ses » Autres (femmes pour les hommes, non-Blancs pour les Blancs, etc.) de ne pas faire partie des Uns, comme si cela ne dépendait que d’eux. Il leur reproche de se distinguer, de n’être « pas pareils », et les exhorte, s’ils veulent conquérir leurs droits, à être plus « pareils ».
Or les différences qu’on leur reproche sont entièrement construites par les groupes maîtres, de plusieurs façons. Elles sont construites idéologiquement par le fait de constituer l’une de leurs caractéristiques physiques ou de comportement non pas comme l’un des innombrables traits qui font que les individus sont des individus distincts les uns des autres, mais comme un marqueur définissant la frontière entre le supérieur et l’inférieur. Plus exactement, l’une des innombrables caractéristiques de l’humanité est constituée en dimension comportant deux pôles, un bon et un mauvais. Parfois il n’existe que deux emplacements sur cette dimension, comme dans la dimension de genre. Le marqueur de cette dimension, le sexe, lui, n’est pas clairement divisé en deux. Quand un bébé naît hermaphrodite, ce qui arrive beaucoup plus souvent qu’on ne le pense et prend beaucoup plus de formes qu’on ne l’imagine, on « rectifie » son sexe chirurgicalement9, au prix de beaucoup d’opérations et de souffrance pour les enfants, afin que ce sexe ressemble à un sexe « normal », soit de l’un soit de l’autre (sexe).
Dans le cas où le marqueur est la couleur de la peau, deux solutions existent. On peut soit construire une division de race clairement bipolaire, comme aux États-Unis, où « une goutte de sang (sic) noir » vous rend membre du groupe inférieur, soit construire une hiérarchie à degrés, comme au Brésil, où le rang social est fonction du degré de blancheur. Ou plutôt, apparemment à degrés ; car la dimension reste unique – celle de la couleur – et celle d’une couleur unique, ne comportant que deux pôles : plus blanc ou plus noir, le premier en haut, et le second en bas10. Ces marqueurs de genre ou de race sont plus ou moins officiels : ainsi, le sexe est-il inscrit sur la carte d’identité, le passeport ; il est non seulement licite de le demander mais aucune interaction ou tractation ne peut avoir lieu tant que le sexe de la personne n’est pas connu11. Aux États-Unis, la race est aussi obligatoirement déclinée, la race supérieure s’appelant « caucasienne » pour des raisons d’euphémisation, mais sa mention est moins souvent « obligatoire » que celle du sexe. En France, la race est traitée aux Antilles sur le mode brésilien de l’échelle et dans l’hexagone plus sur le mode américain du tout ou rien, mais de façon qui doit rester informelle et qu’il est interdit de traiter ouvertement. La déclaration sur la couleur, au contraire de la déclaration sur le sexe, non seulement n’est pas permise, mais est explicitement interdite. Ceci permet à la France d’éradiquer la question à la base : il n’y a pas de races, donc pas de problèmes raciaux. Mais la race, qui n’a que faire des sophismes français, bien qu’elle n’existe pas biologiquement ni officiellement, existe comme marqueur de statut social et concerne aussi des gens qui ne sont ni Blancs, ni Noirs, ni « mélangés ». J’emploie le terme de race pour désigner non une réalité relevant de la génétique...

Toussaint- Messages : 2238
Date d'inscription : 09/07/2010
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
Regards.fr Le grand entretien par Sophie Courval | 6 septembre 2011
Christine Delphy, une voix pour la révolution des femmes
Du Mouvement de libération des femmes (MLF) à l’affaire DSK, la sociologue Christine Delphy est une théoricienne majeure du féminisme. Son livre L’ennemi principal demeure encore aujourd’hui un ouvrage de référence. Cette féministe de la première heure publie aujourd’hui Un troussage de domestique, recueil de textes autour de l’affaire DSK (*).
Regards.fr : Dans votre livre L’ennemi principal vous expliquez l’oppression des femmes sur le même mode que l’oppression des prolétaires : par l’exploitation économique. Pourquoi avoir choisi cet angle matérialiste et quelles étaient les positions des marxistes de l’époque sur les questions féministes ?
Christine Delphy : Mon ambition était donc de mettre au jour l’exploitation économique des femmes. Contrairement aux gauchistes et aux marxistes de l’époque, pour qui l’exploitation des femmes relevait simplement de leur surexploitation sur le marché du travail, j’ai démontré que l’exploitation principale des femmes est le travail domestique gratuit. Et par travail domestique je n’entends pas uniquement le travail ménager, mais l’ensemble du travail qu’elles faisaient- et qu’elles font toujours- au sein des entreprises familiales. Dans les deux cas, il s’agit d’un travail qui est vendu- ou qui pourrait être vendu- sur le marché des biens et des services et pour lequel elles ne reçoivent rien. Dès lors qu’elles travaillent pour leur mari, la même logique est à l’oeuvre. L’argument régulièrement avancé pour justifier cet état de fait est que la production du travail des femmes n’a pas de valeur d’échange. Mais c’est faux. Une femme qui travaille avec son conjoint sur une exploitation agricole produit des biens qui sont vendus sur le marché, sauf que l’argent ainsi gagné va directement dans la poche du mari. Tout cela n’a rien à voir avec l’exploitation capitaliste. C’est une conséquence du statut d’épouse. Dans le cadre de l’exploitation capitaliste, la personne qui travaille perçoit un salaire. Marx fait d’ailleurs une longue démonstration dans Le capital pour expliquer qu’en dépit du fait qu’ils étaient payés, les ouvriers étaient néanmoins, exploités. Il a donc inventé les notions de plusvalue, de surtravail, etc. Mais dans le système d’exploitation patriarcale, il n’y a pas de salaire, ni de vol d’une partie du salaire, il s’agit d’une appropriation du travail des femmes à la source. Le mari peut s’approprier le travail de sa femme et le mettre au service de la tâche qu’il souhaite. C’est lui qui décide.
Regards.fr : L’exploitation patriarcale est donc antérieure au capitalisme...
Christine Delphy : Oui. C’est aussi le mode de production le plus répandu, si on l’envisage au niveau mondial et pas seulement à l’aune des pays dits développés. Certes, dans les pays occidentaux, la part des agriculteurs est très faible, mais dans les pays dits du tiers monde, ils représentent encore 80 % de la population active, et fonctionnent sur un mode de production familiale. Les femmes font partie de cet ensemble que les Romains appelaient la familia. Il ne s’agit pas ici d’une acception sentimentale de la famille, mais d’un ensemble très large incluant l’épouse, les frères et sœurs non marié-e-s, les enfants et les esclaves. Les femmes et les esclaves font donc partie de la même classe, ils doivent non seulement leur obéissance mais aussi leur travail au chef de famille. Évidemment, ce mode de production coexiste très bien avec le capitalisme.
Regards.fr : Le capitalisme bénéficie t-il directement de l’exploitation patriarcale ?
Christine Delphy : Non. Ça, c’est l’argument des marxistes orthodoxes. Selon eux, le travail ménager est utile, voire nécessaire, au capitalisme parce que le travail ménager des femmes permettrait à l’Etat de faire des économies en matière d’équipements collectifs et au patronat de payer moins cher ses salariées. Cela suppose, si l’on suit cette logique, que les salarié-e-s célibataires soient payés plus cher que leurs collègues mariés, pour compenser le fait qu’ils n’ont pas de femme. Or, force est de constater qu’il n’en est rien.
Regards.fr : Toujours dans L’ennemi principal, vous n’hésitez pas à parler de la « classe des femmes ». Comment pensez-vous l’articulation entre classe et genre ?
Christine Delphy : Lorsque je parle de la « classe des femmes », j’emploie le mot « classe » au sens économique du terme. Le fait de former une classe dans ce mode de production domestique est un des nombreux traits du genre. Le genre est une construction sociale, qui partitionne l’humanité en deux catégories de personnes. Le genre prescrit quelle sera votre classe sociale, de la même façon que la race le prescrit aussi. Vous avez davantage de chance de vous retrouver dans une classe inférieure si vous êtes une femme, si vous êtes noire ou arabe... Grâce à l’influence des féministes américaines, qui ont découvert cela bien avant nous, on parle maintenant de la trilogie « classe, race, genre ». Cependant, le concept de classe des femmes n’a pas été beaucoup repris dans les théories féministes. Sans doute en raison de sa connotation marxiste, mais aussi parce qu’il semblait trop agressif envers les hommes.
Regards.fr : Quelles sont les stratégies que les féministes devraient mettre en oeuvre pour réveiller cette conscience de classe ?
Christine Delphy : Le problème majeur auquel sont souvent confrontés les mouvements féministes a toujours été l’éparpillement des femmes dans leur couple, dans leur famille. A cela s’ajoute les discours produits dans les années 1980-1990 affirmant que les femmes avaient tout gagné. Pour que les femmes s’unissent, il faut qu’elles puissent définir elles-mêmes leur oppression, et pour cela il faut absolument privilégier les groupes non-mixtes. La mixité est une arme du patriarcat, car enfin, est-ce que les patrons se retrouvent dans les mêmes groupes que les syndicalistes ? Il faut que les femmes se retrouvent entre elles sans être sous le regard de celui qui est un copain, un petit ami, mais qui appartient aussi à la classe qui opprime, à la classe ennemie, bien qu’il ne soit pas ennemi dans toutes les dimensions. A terme, on risque le conflit d’intérêt. C’est très difficile pour les femmes d’admettre cela, parce que ces hommes sont souvent des personnes avec lesquelles elles souhaitent entretenir une relation individuelle privilégiée.
Regards.fr : Selon-vous quelles sont les enjeux du féminisme aujourd’hui ?
Christine Delphy : Ils sont nombreux... Un des enjeux majeurs est de combattre l’idée que l’égalité homme-femme est acquise et que les combats féministes sont dépassés. De fait, depuis les années 1980, les mouvements féministes ont été écrasés. Et ce, d’une façon insidieuse. Pour exemple, cette année, à l’occasion du 8 mars [1], j’ai de nouveau entendu parler de la Journée de La femme, du statut de La femme. On s’est battu pendant des années afin qu’on parle Des femmes, on croyait que c’était acquis, et bien non ! J’ai cette impression terrible que nous sommes revenus à l’époque des années 1970, voire avant. En matière de violences sexuelles par exemple, l’affaire DSK a souligné le retard de la France dans la prise en charge de ces questions, notamment par rapport à d’autres pays tels que les États Unis. De manière plus générale, la sexualité est un domaine dans lequel nous avons perdu. Il y a bien eu une révolution sexuelle, mais pas au sens où nous l’entendions. Il s’est produit exactement l’inverse, c’est à dire la banalisation de la pornographie, et le rabattement de la sexualité sur la version pornographique qui est tout simplement une version sadique des rapports sexuels. Les femmes deviennent des biens que l’on s’approprie, et sont contraintes à une sexualité de service. On continu à envisager le désir masculin comme un désir impérieux. Et ce besoin n’est pas n’importe quel besoin, c’est le besoin d’avilir les femmes. Il n’y a pas eu de libération sexuelle, parce qu’on ne peut pas avoir une sexualité qui soit à la fois de service et réciproque. Et pour faire passer la pilule, on s’est arrangé pour que les filles fassent semblant de considérer les hommes de la même manière qu’ils les considèrent, comme dans la série télévisée « Sex and the City ». Les hommes ont regagné du terrain dans ce domaine, sans compter qu’ils n’en ont pas forcément perdu ailleurs. Il y a encore une dizaine d’années, on voyait une publicité où un homme tenait une bouteille de liquide vaisselle à la main, tout comme on parlait beaucoup des nouveaux pères alors qu’ils étaient une minorité. On savait très bien que ce n’était pas la réalité, mais on avait l’impression qu’il y avait une sorte d’encouragement. Aujourd’hui, on ne fait même plus semblant. Le partage des tâches n’est plus considéré comme un objectif à atteindre. Certes, dans la réalité les choses ont un peu bougé, les hommes en font un peu plus, mais si l’on regarde les enquêtes d’emploi du temps, on s’aperçoit que ces changements sont mineurs. Dans ce domaine comme dans celui du travail salarié, rien n’a vraiment changé.
Regards.fr : A propos de DSK, vous publiez ce mois-ci, un recueil de textes féministes sur l’affaire, intitulé Un troussage de domestique...
Christine Delphy : Pour moi, ce recueil a un intérêt historique. En consultant la presse au moment où l’affaire a éclaté, j’ai trouvé très intéressant que des femmes réagissent sur les mêmes thèmes. Tous les textes dénonçaient la confusion volontaire entre sexualité et viol- comme si le consentement n’avait pas de valeur- l’indifférence pour la victime, le retard de la France sur les questions de violences sexuelles, l’idée d’une solidarité d’hommes, la remise en cause de la parole de la victime, et l’effet de classe. Quand je pense qu’on a accusé la justice américaine d’avoir nui à l’image de la France... Pour moi, ce qui a nui à l’image de la France, c’est surtout la presse française. On accusait les Français, et les « latins » en général d’être sexistes, mais on ne pouvait pas imaginer à quel point la réalité était pire que les stéréotypes !
Ce recueil est très limité dans le temps : il s’arrête début juillet, et en général, bien avant. Toute la saga ne se déroule pas, car s’il avait fallu attendre son dernier chapitre, on n’aurait jamais rien publié. Or cette saga continue, avec son lot de scandales, du point de vue féministe bien sûr. Rien de la version des faits de la « victime présumée » n’est infirmé, mais le procureur hésite à aller au procès parce qu’elle serait « décrédibilisée ». Or pour les gens de sa classe sociale, avoir menti pour obtenir une carte de séjour n’est pas un signe de malhonnêteté, c’est un savoir indispensable pour survivre. Pour meilleur qu’il soit aux Etats-Unis, le traitement des victimes d’agressions sexuelles est encore la proie d’idéologies d’origine religieuse qui veulent que les personnes soit mentent tout le temps, soit ne mentent jamais, et surtout d’idéologies patriarcales qui permettent que le passé des victimes soit passé au crible, alors qu’il est interdit de mentionner quoi que ce soit de celui des prévenus. J’espère que d’autres recueils se feront, qui seront autant de bornes kilométriques, de points de repère historiques : car c’est notre propre histoire de féministes qui nous manque le plus. C’est à faire celle-ci, sur le moment, et avec ses actrices, qu’ Un troussage de domestique s’emploie.
(*) Sophie Courval, auteure de cet entretien, et Clémentine Autain, co-directrice de Regards ont chacune rédigé une contribution à cet ouvrage, en librairie depuis le 1er septembre. A lire sur regards.fr : Anne Sinclair, l’autre visage du sexisme de Sophie Courval et Affaire DSK : l’impensable viol de Clémentine Autain.

Toussaint- Messages : 2238
Date d'inscription : 09/07/2010
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
http://www.liberation.fr/debats/2015/11/05/ou-sont-les-feministes-mainstream_1411495?xtor=rss-450Où sont les féministes mainstream ?
Par Océane Rose Marie, Auteure et comédienne — 5 novembre 2015 à 18:08
Plus de trente ans après la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983 et dix ans après les révoltes urbaines de novembre 2005, un collectif de femmes a organisé une Marche de la dignité, samedi 31 octobre, à Paris.
Samedi après-midi a eu lieu un événement historique : pour la première fois en France, une marche a été organisée par des femmes qui luttent au quotidien contre le racisme, des femmes qui sont en premières lignes, des femmes de terrain, des militantes. Militantes parfois malgré elles, parce que leur frère ou leur fils a été tué par la police, et qu’elles ont vu leur vie basculer. Une marche splendide, pas organisée par des syndicats, un parti politique ou une association pilotée par le gouvernement. Non, une marche dont l’appel a été lancé par Amal Bentounsi, sœur d’Amine, tué d’une balle dans le dos par la police en 2012, et rejoint par d’autres familles de victimes de crimes policiers, celles de Lamine Dieng, Ali Ziri, Amadou Koumé, Abdoulaye Camara, Mourad Touat, Hocine Bouras, Wissam El Yamni, Lahoucine Ait Omghar… Des noms qu’on ne connaît que trop peu, des noms qui racontent des morts injustifiées, et des policiers qui s’en sont tous sortis malgré tous les éléments à charge.
Une marche organisée avec ces familles, par des femmes racisées (pour rappel, être «racisé», c’est être victime de racisme et désigné comme «autre», ce n’est pas essentialiser la race, hein, bisou Nadine), des associations antiracistes et des collectifs féministes : le collectif Mwasi, Femmes en lutte 93, Mamans toutes égales, Collectif des féministes pour l’égalité, les Femmes dans la mosquée et j’en passe. Une marche soutenue par des partis et syndicats de gauche (dont EE-LV, le NPA, Ensemble, le Parti de gauche et la CGT Paris) qui ont rejoint la fin de cortège. Pas devant mais derrière, en soutien à l’initiative… et c’est ça qui était enfin cohérent. Parce que les luttes doivent être portées par les personnes concernées en premier lieu.
Derrière ces femmes, en revanche, aucune trace d’Osez Le féminisme, Féministes en mouvement, La Barbe, les Femen (lol), les Chiennes de garde, Ni putes ni soumises (double lol), ou autre association féministe de premier plan. Cela interroge. Faut-il en conclure qu’aucune de ces associations ne s’est reconnue dans le combat pour la justice porté par les 70 femmes de la Mafed (Marche des femmes pour la dignité) ? Le message était clair : nous vivons dans un pays où la justice et la police sont à deux vitesses et où celles et ceux qui ont une gueule d’Arabe, de Rom ou de Noir, pour peu qu’ils vivent en plus dans un quartier populaire, en font les frais. La routine se résume à un contrôle au faciès, à des violences policières (verbales ou physiques) et peut conduire, dans le pire des cas, à des crimes policiers.
J’étais à cette marche en tant qu’alliée certes, mais aussi parce que je suis concernée : je refuse de vivre dans une société injuste, où le racisme d’Etat s’exprime quotidiennement au travers de ces abus policiers, de l’arbitraire judiciaire et carcéral. Beaucoup de gens «de gauche» m’ont reproché d’avoir signé l’appel et d’y avoir participé. Ce serait une initiative «communautariste», «identitaire», ou encore «dangereuse». Ah bon ?
Ce n’est pas ce que j’ai vu samedi. Ce que j’ai vu ce sont des femmes et des hommes affirmant leur dignité et dénonçant les discriminations structurelles qui les touchent. Une mère m’a expliqué s’être engagée auprès de la BAN (Brigade antinégrophobie) quand elle a eu son fils. Parce qu’elle a peur pour lui. Qu’elle se sente, elle, dans une certaine insécurité passait encore, m’a-t-elle dit, mais imaginer que son fils puisse subir ça, qu’il puisse se faire courser par des flics pour rien, que sa vie soit en danger pour rien, ça non elle ne pouvait pas le supporter. Qu’on m’explique ce qu’il y a de «communautariste» dans cette démarche.
A tous les gens de gauche, voici ce que je voudrais dire : je suis blanche, lesbienne, bourgeoise, féministe, militante des droits LGBT, j’ai été à la marche de la Dignité et je déplore l’absence de toutes les féministes dites «intersectionnelles» et de toutes celles et ceux qui partagent mes combats. A ces gens, je voudrais poser une simple question : Quand il s’est agi d’aller marcher le 11 janvier avec une pancarte «Je suis Charlie», vous êtes passés outre la présence de certains dictateurs ou de personnalités de la droite française… par ce que la «liberté d’expression» et le deuil national étaient plus importants que ça et qu’il fallait à tout prix être rassemblés autour de valeurs communes, malgré les divergences sur de multiples sujets. Alors sincèrement, pourquoi, quand il s’agit de soutenir ici aussi des familles de victimes, de combattre un racisme systémique, d’exiger que notre système judiciaire, carcéral et policier soit le même pour tous, pourquoi tout d’un coup la présence de «signataires louches» pour cet l’appel vous gêne-t-elle ? Comment justifiez-vous ces différences de traitement ?
Je crois que j’ai la réponse. Au fond, vos «valeurs républicaines» se foutent pas mal des injustices qui s’abattent sur les plus pauvres, les descendantes de l’Empire colonial français, ceux qui ne vous ressemblent pas et qui vous renvoient à la gueule une image brisée de la société. Ce ne sont pas vos potes qui étaient dans la rue ce samedi 31 octobre, pas vos connaissances, pas votre réseau. On m’a accusée d’avoir osé répondre à un appel du PIR (Parti des indigènes de la République), qui a participé à cette manifestation ; l’initiative a beau avoir été lancée par une sœur de victime et une multitude de femmes, on prend toujours quelques signatures pour essayer de discréditer (en multipliant les amalgames et les raccourcis d’ailleurs) un événement.
Je serais inconséquente, stupide, naïve, «angeliste» et désormais sans doute aussi antisémite et islamiste… Le comble pour une gouine féministe ! Mais vous, qui m’accusez de marcher avec le PIR, vous faites quoi au juste ? Vous, les associations féministes qui vous battez pour l’égalité des salaires et contre la taxe tampon (ce que je trouve super au demeurant), vous la Dilcra (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, ndlr), vous organisez quoi pour les femmes qui se font agresser tous les jours parce qu’elles portent un voile, pour les familles des victimes de violences policières, encore une fois ?
Je crois qu’on peut avoir vos idéaux (que la prostitution disparaisse, que le voile disparaisse, etc.) et être néanmoins pragmatique, mener des combats politiques dans lesquels les principes ne priment pas sur les victimes, et ne pas incriminer ceux et celles qui sont déjà en première ligne des discriminations.
Vous qui vous êtes battues pour qu’on ne parle pas à votre place quand on vous disait manipulées, incapables de tenir un chéquier ou d’avoir le droit à l’avortement, vous qui savez l’importance de faire entendre vos voix quand les dominants voudraient parler à votre place : allez à la rencontre de ces femmes, des familles des victimes, de toutes les signataires de l’appel, et osez me dire en face que ce ne sont pas des femmes autonomes, qu’elles ne pensent pas par elles-mêmes ou qu’elles sont manipulées par je ne sais quel courant extrémiste qui n’existe que dans des fantasmes propres aux délires racistes.
S’il vous plaît, ne reproduisez pas un système d’oppression construit sur la suspicion, la délation, l’incitation à la haine, sans écouter celles et ceux qui exigent d’être enfin entendues, fatiguées qu’on parle à leur place.
Malheureusement, quand on veut changer les choses, on doit s’associer à des groupes ou des individus qui ne pensent pas comme nous sur TOUT. Si je ne marchais qu’avec des gens qui pensent comme moi de A à Z, et donc militent à la fois pour les droits des trans à changer d’état civil, la PMA, l’abrogation de la loi de 2004 sur le voile et contre la loi abolitionniste qui menace les prostituées, je pense qu’on serait 12, et encore, je compte ma mère et mes chatons ! Donc oui, je pense qu’il faut respecter certains agendas, entendre que les questions de vie ou de mort sont prioritaires sur tout le reste, et surtout ne pas oublier que ces questions de droits humains et de justice nous concernent tous.
Et si demain encore il faut aller dans une manif aux côtés de certaines personnes qui ne soutiennent pas le mariage pour tous, avec une association pro-Hamas, ou encore avec des partis politiques dont je ne partage pas la vision, et bien vous savez quoi, j’irai quand même, tant que le mot d’ordre de cette manif ne sera autre que «JUSTICE POUR TOUS ». Et je ne saurai que trop vous encourager à faire de même au lieu de crier aux « replis communautaires », quand le plus gros et le plus violent repli communautaire auquel j’assiste aujourd’hui est celui d’une élite blanche, bourgeoise, dominante, agressive, serrant en tremblant contre son sein son lot de privilèges comme Harpagon s’agrippe à sa bourse.
MO2014- Messages : 1287
Date d'inscription : 02/09/2014
 Re: Féminisme
Re: Féminisme
Lire en particulier le passage sur Lutte Ouvrière... très juste.
http://www.revue-ballast.fr/zahra-ali/
« Décoloniser le féminisme »
Zahra Ali :
Lier féminisme et islam n'est pas sans faire question : souvent, les féminismes occidentaux redoutent l'intrusion du religieux — patriarcal et régressif — et les espaces musulmans craignent le chantage néocolonial à l'émancipation des femmes. Sociologue et auteure, en 2012, de l'essai Féminismes islamiques, Zahra Ali s'empare de cet « oxymore » pour en exposer ce qu'elle nomme les « a priori » réciproques. Celle qui milita contre l’exclusion des élèves portant le foulard appelle à contextualiser, historiciser et rejeter les essentialismes : condition nécessaire à la création d'un féminisme international et pluriel.
z_ali« On me nie le droit de me revendiquer en tant que féministe », avez-vous déclaré un jour, lorsque vous portiez le foulard. Qui sont donc les juges et les distributeurs de licences en conformité ?
Bonne question. Dire que l’on parle depuis la marge ne veut certainement pas dire que l’on érige celles et ceux qui sont au centre en modèles normatifs. Mais c’est faire reconnaître que celles et ceux qui ont le monopole et la légitimité de se définir comme féministe, progressiste et égalitariste le font dans l’exclusion d’autres formes d’émancipation — et, de ce fait, ne sont pas aussi féministes et égalitariste qu’ils le prétendent. Le féminisme blanc, bourgeois, dominant est porteur, en France, d’une vision normative de l’appartenance au collectif : c’est celui qui nie les expressions alternatives de la lutte contre le patriarcat et pour l’égalité. Un discours et des pratiques de « féministes » qui n’appliquent leur conception de l’égalité qu’à une catégorie de femmes : celles qui assimilent émancipation à occidentalisation et sécularisation.
Vous vivez à présent en Grande-Bretagne et faites savoir qu'il y est beaucoup moins difficile pour les femmes de porter le foulard, de trouver un emploi ou de poursuivre des études. Vous assurez que les autorités françaises ont condamné les diplômées le portant à faire des ménages. Comment comprendre ce décalage ?
« La Grande-Bretagne a aussi son passé colonial et son propre racisme : je ne veux absolument pas l’ériger en modèle. »
Sur le voile, la France est en dehors du monde : archaïque dans sa focalisation et son incapacité à reconnaître et régler son héritage colonial. Les femmes qui portent le foulard sont considérées comme la figure par excellence de l’opprimée à libérer ; elles sont essentialisées et infantilisées. En plus d’être clairement raciste et paternaliste, ce discours — qui est aujourd’hui celui du « sens commun » en France (pour reprendre l’expression bourdieusienne) — enferme les femmes et les jeunes femmes qui portent le foulard dans leur étrangeté et leur aliénation. D'autant plus lorsqu’il est suivi d’une législation contre-productive. On exclut de l’école et du travail, principaux lieux de socialisation, des femmes et des jeunes femmes au prétexte de les libérer. La Grande-Bretagne a aussi son passé colonial et son propre racisme : je ne veux absolument pas l’ériger en modèle. Néanmoins, il est clair que lorsque l’on porte le voile, ou que l’on veut exprimer et pratiquer toutes formes de religiosité, elle est un espace de vie plus accueillant. Le monde académique anglo-saxon est aussi plus intéressant pour parler des questions de religion, de racialisation et de féminismes alternatifs. En France, les études post-coloniales sont, par exemple, encore à leur stade d’émergence — alors qu'elles sont considérées, ailleurs, comme des acquis.
Vous distinguez la laïcité originelle, dans sa lettre et son esprit, et l'usage « laïcard » qu'il en est trop souvent fait : faites-vous vôtre cette notion de « laïcité falsifiée » portée par l'historien Jean Baubérot ?
Oui. J’aime beaucoup ses travaux sur le sujet. Je pense aussi qu’il y a falsification d’un idéal très positif, à l’origine, à savoir la neutralité de l’État face aux différentes confessions et religions — et, de ce fait, leur traitement sur une base égalitaire. Or, ce qui est aujourd’hui à l’œuvre, c’est que l’on évoque la laïcité pour dissimuler des prises de positions racistes et islamophobes. Car c’est toujours de la religion musulmane dont il est question. Une religion toujours reléguée à son statut de culte « étranger », mais aussi archaïque et barbare. D’ailleurs, s’il y a bien une dimension de rejet de la religion en tant que telle chez de nombreuses féministes qui stigmatisent les musulmanes, il serait faux de réduire cette question à une histoire franco-française de la laïcité. C’est bien d’une histoire franco-française dont il est question, mais c’est surtout d’une histoire coloniale, ou la religion de l’Autre, l’Arabe, le musulman, doit s’effacer de la sphère publique.
Certaines formations révolutionnaires et internationalistes avaient approuvé l'interdiction du foulard à l'école au nom de l'égalité des sexes ou du combat contre l'aliénation monothéiste – songeons à Lutte ouvrière. Concevez-vous que certains puissent s'opposer au foulard de façon émancipatrice ou est-ce forcément un marqueur de rejet ethnique ou confessionnel ?
Je pense qu’on peut s’opposer au port du voile sans être raciste, évidemment. Mais on ne peut pas décontextualiser le débat. Ce débat et la loi de 2004 ont eu lieu en France, dans un contexte où l’islam était stigmatisé — on évoquait l’archaïsme et l’obscurantisme d’une catégorie de la population uniquement, celle considérée éternellement « d’origine étrangère », et celle des banlieues. Encore une fois, je peux tout à fait imaginer qu’une partie de l’extrême gauche, en France, ait une réticence quant à l’association entre lutte politique et pratique religieuse. Oui, il y a eu une histoire de l’Église dans ce pays, qui a opprimé pendant des siècles et fait la promotion d’une organisation sociale et familiale inégalitaire et patriarcale. Mais, encore une fois, ayant vécu cette période des débats sur le voile de 2004-5, et ayant participé aux mobilisations et aux discussions avec les militants d’extrême gauche à l’époque, ce n’est pas uniquement la frilosité vis-à-vis de ma pratique religieuse dont j’ai été témoin, mais bien d’un mépris lié à mon arabité, mon « étrangeté » et mes soi-disantes « coutumes barbares ». J’ai été reléguée au statut de victime, considérée comme aliénée par mes pères et frères ; j'ai été considérée comme dangereuse ou opérant pour des réseaux obscurantistes et fondamentalistes. Et puis, encore une fois, la guerre d’Algérie n’est pas si loin. Je crois au contraire que ces débats ont dévoilé un héritage colonial inassumé — y compris dans l’extrême gauche. Il faut le dire : souvent, les forces politiques qui s’érigent comme progressistes en France sont également teintées d’un universalisme républicain qui se croit supérieur et souhaite éduquer ou civiliser… Il est dangereux de se croire le détenteur d’un modèle d’émancipation et, tout à la fois, de s’inscrire dans un discours d’identité nationale excluant. C’est là que se situe une partie de l’extrême gauche dans ce pays.
Vous avez beaucoup travaillé sur la question du féminisme islamique. Vous y brossez trois courants principaux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette notion, ou qui la trouvent paradoxale dans son seul énoncé : que sont-ils, à grands traits ?
« J’ai été reléguée au statut de victime, considérée comme aliénée par mes pères et frères. »
D’abord, j’utilise ce terme au pluriel pour montrer qu’il y a diversité des expressions des féminismes s’inspirant du cadre religieux musulman, et diversité de ses contextes d’expression et de déploiement. L’idée étant que des femmes se ressaisissent du cadre religieux et réinterprètent les sources scripturaires — notamment le Coran, dans un sens égalitariste et émancipateur. Les féministes musulmanes ont en commun de considérer que le message coranique est émancipateur et que ce sont les lectures patriarcales qui se sont imposées à travers le temps qui ont trahi ce message. Le spectre va de féministes radicales à des féministes plus réformistes quant à leur appréhension desdites sources. Il y a une vraie diversité et autant de lectures que de contextes. Maintenant, en termes d’engagement social et politique, les féminismes qui s’inspirent de la religion musulmane opèrent selon des stratégies très différentes : dans le contexte français, les féministes musulmanes sont aussi des militantes qui cherchent à imbriquer antiracisme à antisexisme. Dans d’autres contextes, comme celui des pays dont la population est majoritairement musulmane et qui imposent aux femmes le Code de la Famille, les stratégies sont différentes. Le Code de la Famille repose sur une lecture conservatrice de la jurisprudence religieuse. Dans ce contexte, les féministes musulmanes, comme celles réunies autour de la plateforme Musawah, travaillent à la réforme de ses codes en proposant une lecture féministe des différentes jurisprudences musulmanes.
Les féminismes islamiques ont, expliquez-vous, deux adversaires : le féminisme occidental, qui lui nie ses qualités féministes, et une partie de la pensée islamique qui rejette le féminisme comme création occidentale. Vous expliquez pourtant que le féminisme non-occidental est né à la même période et qu'il existe un « protoféminisme » dès les premiers temps musulmans. C'est-à-dire ?
Déjà, il faut commencer par dire qu’il n’y a pas de « féminisme occidental » : les différents mouvements féministes de cette aire géographique que l’on appelle l’Occident sont pluriels. C’est un courant parmi cette aire, hégémonique malgré tout, qui considère qu’émancipation est synonyme d’occidentalisation. Pour se libérer du patriarcat, toutes les femmes devraient suivre un modèle unique qui consisterait à mettre à l’écart le religieux, à faire la promotion de valeur dites « occidentales ». Au final, parmi les musulmans, ceux qui considèrent le féminisme comme une forme d’occidentalisation rejoignent complètement le discours islamophobe des féministes hégémoniques. Ce qu’ont en commun ces deux discours est leur essentialisation de l’islam et de l’Occident — or ni l’un ni l’autre n’existe au singulier. Il y a différentes manières d’appréhender et de vivre la religion musulmane. Cet « Occident » n’a pas le monopole des valeurs humaines d’émancipation et d’égalité. Il a existé partout, y compris dans des contextes où la population est majoritairement musulmane, des formes d’émancipation et de lutte contre le patriarcat et les inégalités.
zali2
Ce refus des essentialismes et ce souci de la pluralité est d'ailleurs au centre de l'ouvrage État des résistances dans le Sud, auquel vous avez contribué...
Oui. J’insiste sur l’importance de la prise en compte du contexte et le refus de tout essentialisme. Certaines féministes musulmanes elles-mêmes ne sont pas à l’abri de tomber dans l’essentialisme, en voulant faire la promotion d’« un » islam qui serait émancipateur. Ici, la question de la classe est aussi importante : la pensée féministe musulmane s’articule dans des cercles intellectuels, bien-pensants, très élitistes. Il faut rester très attentif aux dimensions de classe, car les féministes musulmanes de classes moyennes éduquées ne sont pas nécessairement les mieux placées pour parler d’égalité. Pour moi, être féministe, c’est englober toutes les formes d’inégalité, c’est être intersectionnelle, c'est remettre en question sa position de manière permanente, c'est reconnaître la pluralité des expressions de l’émancipation des femmes et des hommes.
L'Irak occupe une place importante de votre réflexion. Vous écrivez notamment que ce pays permet de comprendre les liens entre genre, nationalisme et impérialisme. De quelle façon ?
« Il faut rester très attentif aux dimensions de classe, car les féministes de classes moyennes éduquées ne sont pas nécessairement les mieux placées pour parler d’égalité. »
Ce serait très long à expliquer ! Mais ma recherche s’intéresse à l’histoire sociale, économique et politique des femmes irakiennes et à l’évolution des mouvements féministes irakiens depuis la formation de l’État moderne. Je m’intéresse notamment à la manière dont ces mouvements se sont organisés après l’invasion américaine de 2003. Je montre comment, notamment à travers les mobilisations autour du Code de la Famille (ou Code du Statut personnel), les questions de genre se sont reposées en Irak sur un mode confessionnel, lié à l’état général de destruction et de défaillance des institutions de l’État irakien — qui, depuis 2003, sous l’impulsion de l’administration américaine, est régi par un système ethno-confessionnel. La société et le territoire irakien sont maintenant fragmentés sur une base ethno-confessionnelle (Arabes/Kurdes, sunnites/chiites) et le régime au pouvoir a proposé, dans ce contexte, d’imposer cette fragmentation à la sphère des droits des femmes. Dans un contexte de résurgence de conservatismes sociaux et religieux et de violence politico-confessionnelle généralisée, la confessionnalisation du Code du Statut personnel signifie un retour en arrière en matière de droits des femmes.
Vous vous revendiquez d'Angela Davis et de Chandra Talpade Mohanty. Nous avions interviewé la première, qui nous fit savoir qu'il fallait « comprendre la manière dont la race, la classe, le genre, la sexualité, la Nation et le pouvoir sont inextricablement liés ». Comment, pour votre part, concevez-vous la lutte du peuple contre les possédants, c'est-à-dire la lutte des classes ?
C’est encore une question qui mériterait des heures de discussion. Ce que je peux dire, très simplement, c’est qu’on ne peut pas promouvoir l’émancipation humaine sans prendre en compte les différentes dimensions de l’oppression et des inégalités. Cela ne veut pas dire que tout se vaut : la classe, la race, le genre, la sexualité, etc. Mais qu’il faut rester attentifs à la manière dont les inégalités s’imbriquent et se nourrissent les unes aux autres. Il faut rester vigilant quant à leurs transformations et savoir revoir ses catégories au gré de l’évolution sociale et politique. J’aime cette idée de Chandra Talpade Mohanty qui dit qu’être féministe, c’est rester au « plus près » des réalités — et donc les analyser telles qu’elles émergent, et non à partir d’un schéma idéologique ou politique préétabli. Il faut écouter et être attentif à la souffrance pour ce qu’elle est, et non pas uniquement à partir de notre manière personnelle et située de la vivre et de la définir. Commencer par se situer soi-même est essentiel. Situer sa parole, situer d’où l’on parle, plutôt que d’universaliser ses énoncés, est une première étape. Tout le monde est situé socialement, économiquement, politiquement, etc. Et construit un discours depuis une position — et pour certaines raisons.
Vous l'avez évoqué : toutes ces études sont parfois vues comme des productions universitaires et élitistes qui ne trouvent pas d'écho dans la base, sur le terrain...
... Cela est directement lié à ce que je viens d’évoquer : tout le monde est situé. C’est sûr, les productions universitaires et intellectuelles sont élitistes : il faut maîtriser certains codes, avoir un « capital » culturel et intellectuel pour pouvoir y accéder. Mais cela n’empêche pas leur nécessité. Aussi, il me semble que via Internet et des médias alternatifs comme votre site, il y a un accès plus grand aux outils de la pensée critique.
Bien des hommes se découvrent féministes dès qu'il est question d'islam, alors qu'ils sont les premiers à se moquer des féministes toujours trop « excessives ». Vous appelez donc à « décoloniser le féminisme », expliquant que ce serait même « une chance » historique pour l'ensemble du mouvement féministe...
... Décoloniser le féminisme veut dire reconnaître les dimensions de classe et de race dans la pensée féministe hégémonique, et mettre à égalité les différentes expressions de la lutte contre le patriarcat, sans supposer une forme linéaire d’évolution des formes de luttes sociales et politiques.
MO2014- Messages : 1287
Date d'inscription : 02/09/2014
Page 7 sur 8 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Manif du 8 mars
» Féminisme et racisme
» Féminisme révolutionnaire
» Osez le féminisme
» feminisme et communisme primitif
» Féminisme et racisme
» Féminisme révolutionnaire
» Osez le féminisme
» feminisme et communisme primitif
Page 7 sur 8
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum